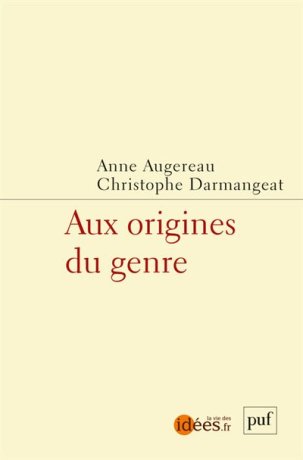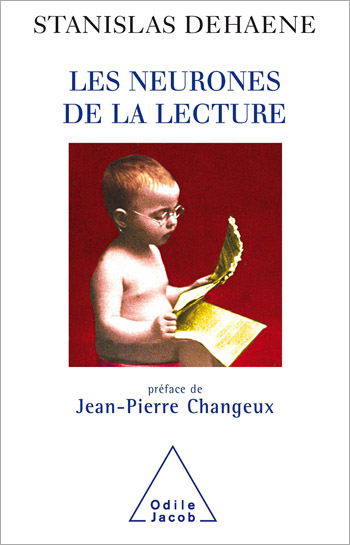Sept ans après l'écriture de son ouvrage sur les mécanismes neuronaux de l'apprentissage de la lecture Stanislas Dehaene reprend un travail dans la même veine, mais plus général, sur le fonctionnement du cerveau : la conscience. La tâche commence par la définition de ce qu'est la conscience, dotée d'une longue histoire de tentatives de définition philosophique. Son défi est de désormais définir la conscience, aux mécanismes demeurés si mystérieux jusqu'ici, de manière scientifique.
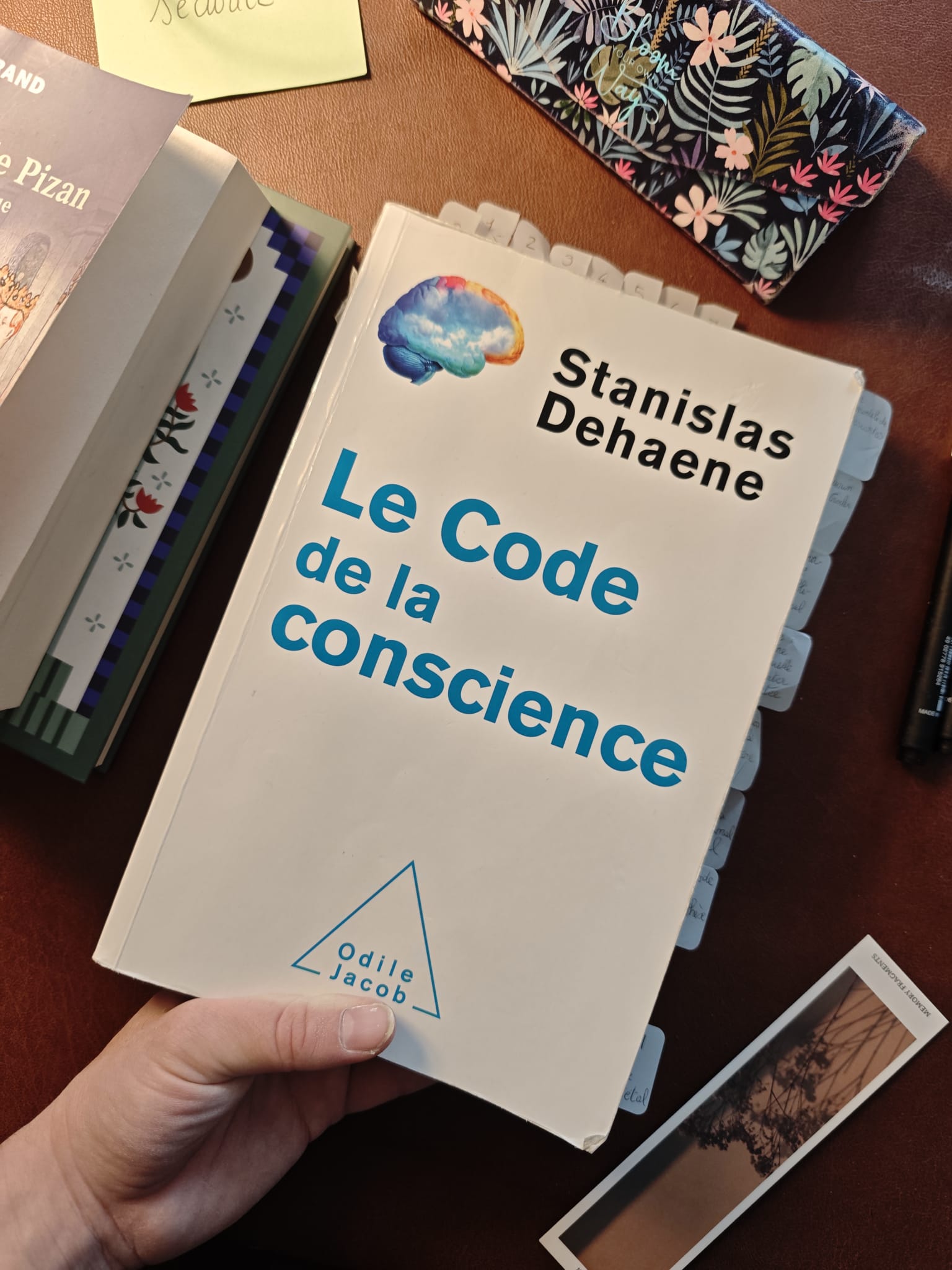
Le scientifique utilise des dispositifs technologiques comme l'électro-encéphalographie, l'imagerie par résonnance magnétique, ou encore la méthode de l'amorçage subliminal pour déterminer quel est le seuil entre l'information inconsciente et son accès au mode conscient. Il a ainsi déterminé quatre marqueurs de l'activité consciente du cerveau : une embrasement soudain de l'activité cérébrale en "tout ou rien, un pic d'activité à 300 millisecondes après la perception, des ondes gamma émises par les neurones activés, enfin une synchronisation de ces signaux dans des aires cérébrales éloignées.
C'est à partir de ces «signatures de la conscience» qu'il élabore sa théorie de l'espace neuronal global : le réseau formé par les différentes aires cérébrales activées serait à l'origine de cette sensation de conscience, qui permet au cerveau de comparer des informations et des raisonnements complexes afin de prendre des décisions importantes et de s'adapter à des situations nouvelles. Pour prouver cette théorie et le reste des éléments qui l'ont mené à l'élaborer Stanislas Dehaene explique avec précision et clarté chaque étape de son cheminement scientifique : premièrement il formule son hypothèse, puis il met en place une expérience en expliquant le choix de la forme du dispositif. Après le déroulement de l'expérience, il en annonce les résultats, qu'il analyse et il en tire ses conclusions.
Tout au long de son ouvrage, Stanislas Dehaene prend soin de nous amener progressivement à comprendre le fonctionnement du cerveau sans besoin d'aucune connaissance préalable en neurosciences. Le lecteur est guidé pas à pas dans le cheminement de l'auteur. Il commence par la notion philosophique, récapitule les premières découvertes liées à la conscience, pour enfin nous amener aux dernières découvertes et en particulier à celle qu'il a élaborée. Mais, celle-ci n'est pas une fin en elle- même puisqu'il la présente comme le maillon d'une longue chaîne de découvertes ultérieures
Les applications du décodage de la conscience commencent déjà à fournir des améliorations dans le domaine médical : il peut en effet aider à identifier si des individus dans le coma ou en état végétatif apparent ont ou pourront récupérer des facultés cognitives et motrices. Toujours dans le même domaine, ces nouvelles connaissances peuvent permettre de les aider à communiquer avec leur entourage et même agir dans leur environnement.
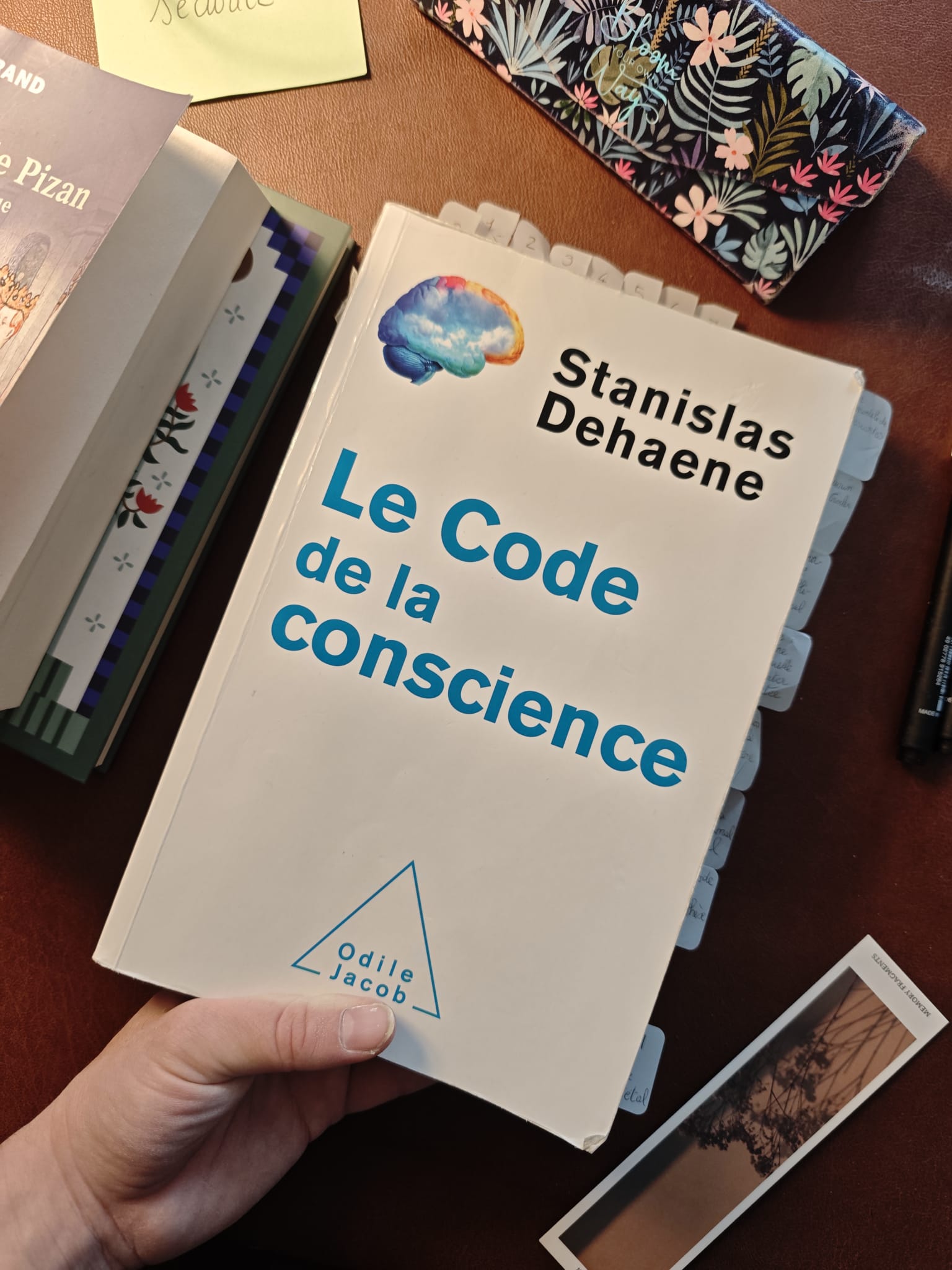
L'ouvrage se termine comme il a commencé : par une réflexion philosophique sur la conscience. Mais il ne s'agit plus de la définir, il faut plutôt se demander à quels autres êtres elle s'applique. D'après les manifestations cérébrales définies à travers le travail de Stanislas Dehaene, peut-on en conclure que les bébés sont doués d'une conscience ? Selon lui, les bébés présentent bien les manifestations de la conscience mais de manière plus limitée que l'adulte. Une sorte de conscience en construction. Mais les singes, qui sont nos lointains cousins ? Et les autres animaux ? Et les machines fonctionnant sous intelligence artificielle? Malgré les études qui définissent précisément les manifestations biochimiques de la conscience dans le cerveau chez l'être humain, leur mise en application chez les autres espèces ne donne pas de réponse aussi tranchée. Ainsi pouvons. nous prédire de longs jours encore à la question philosophique et éthique de la conscience.