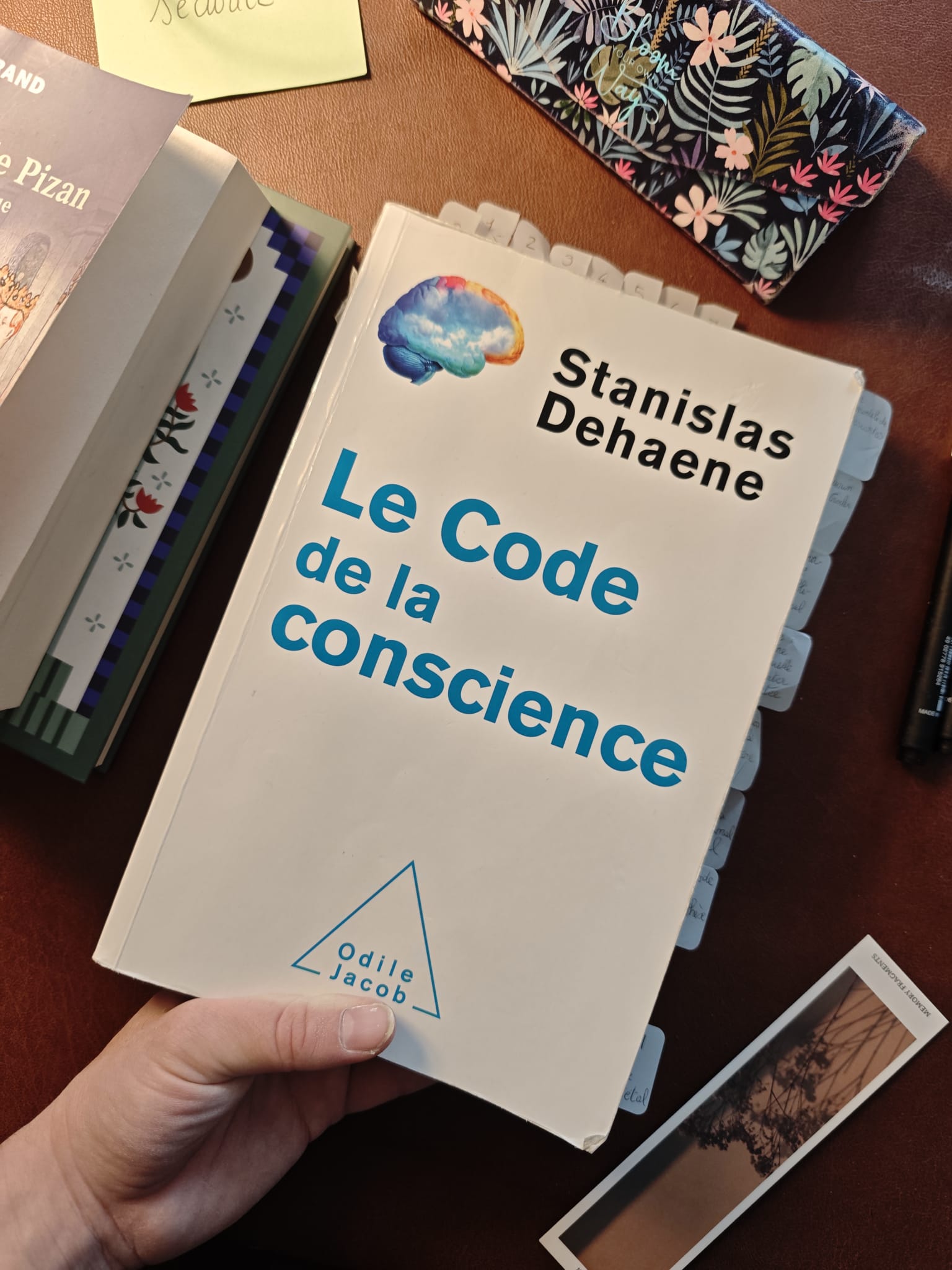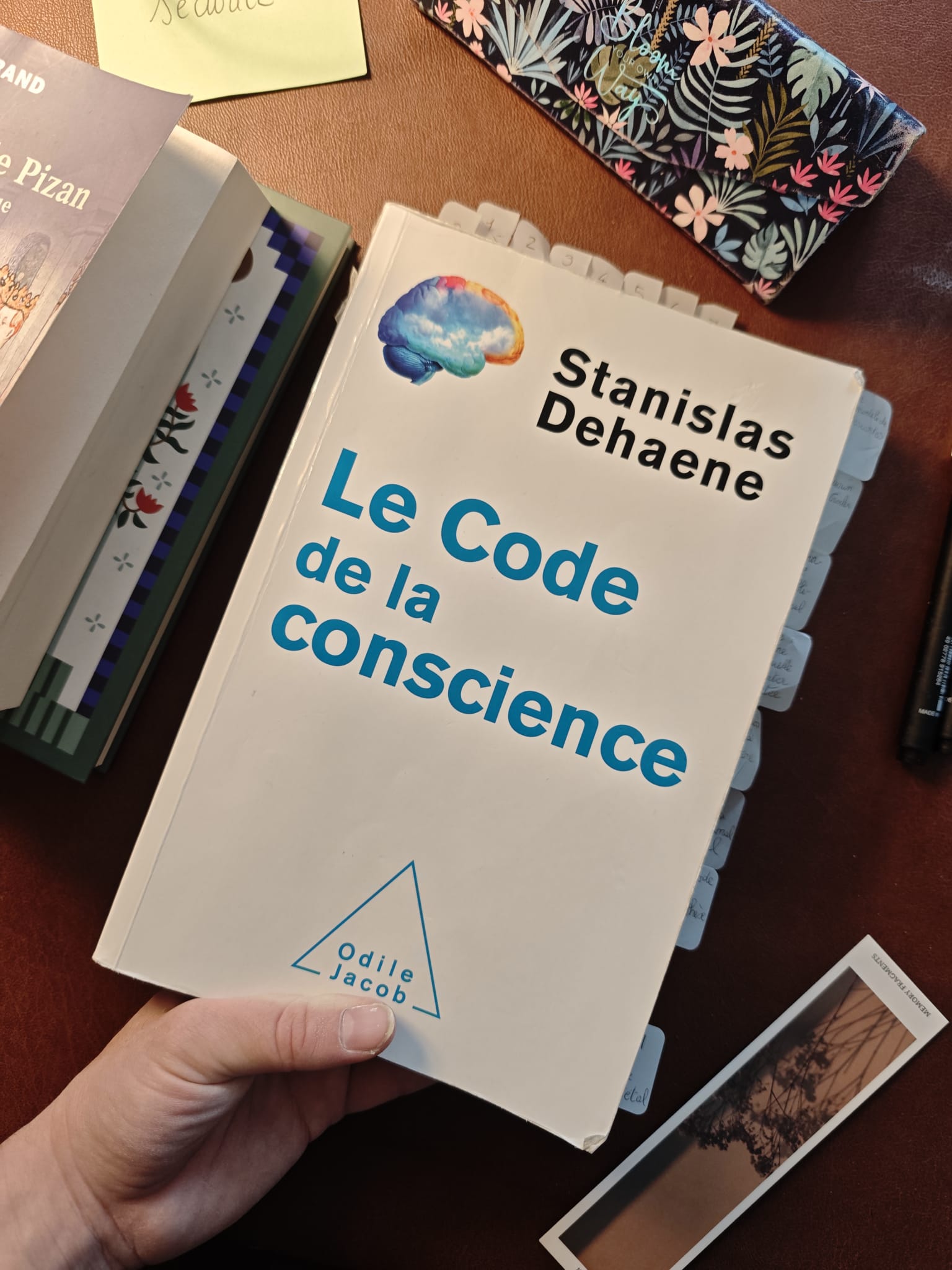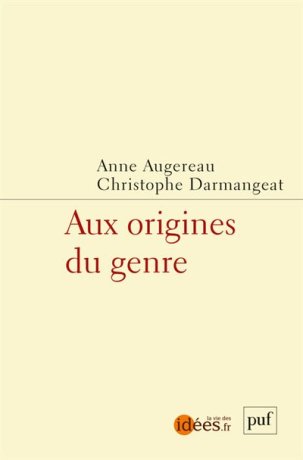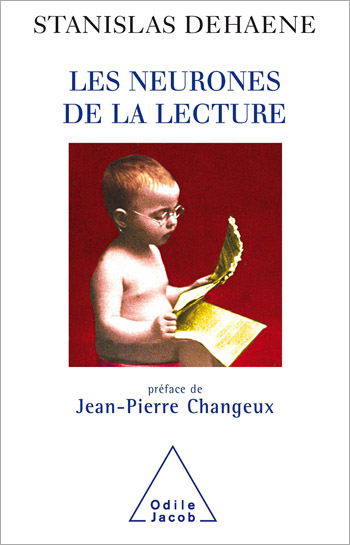DÉFINITION ET ORIGINES DU TROUBLE
Le TDAH est un trouble psychique défini par le DSM-51, le manuel de référence des professionnels de la santé mentale pour la description et le diagnostic des troubles. TDAH est l'acronyme de Trouble De l'Attention avec Hyperactivité et il se définit autour de la réunion de trois symptômes2 , que ce soit dans le domaine intellectuel ou moteur :
- la difficulté à maintenir son attention,
- un état d'agitation difficile à réprimer,
- une impulsivité dans les actes, les prises de parole.
Le TDAH se manifeste à cause d'un trouble dans le développement du cerveau3. Certaines zones du cerveau comme le lobe frontal, le cortex préfrontal, le cervelet ont un développement différent qui ont un impact sur le comportement et les apprentissages. Par exemple, le lobe frontal ne remplit pas bien ses fonctions de contrôle des émotions et d'inhibition pour la prise de décision et pour l'impulsivité. L'équilibre chimique du cerveau est aussi perturbé : les neurotransmetteurs sont des molécules permettant de faire passer les messages entre le neurones dans le cerveau. La dopamine, hormone de la motivation, et la sérotonine, hormone du calme et de la sérénité, et récemment la noradrénaline4,impliquée dans la gestion du stress, seraient les principales molécules en jeu dans le déficit.
Ces dysfonctionnements touchent donc le cerveau dans sa globalité et son équilibre développemental est chimique, il est donc complexe de savoir où agir pour réguler ce trouble. Les causes de ce trouble développemental sont majoritairement héréditaires mais elles peuvent être aussi liées aux événements pendant la grossesse ou peu après la naissance, par exemple le faible poids à la naissance, la carence en fer, une exposition à certaines substances 5 6 . L'environnement pourra ensuite favoriser ou non le développement plus ou moins prononcé du trouble.
UNE MÉDICAMENTATION CONTROVERSÉE
Contre les effets délétères de ce trouble, notamment dans la vie quotidienne familiale et la bonne réussite scolaire de l'enfant, un médicament est aujourd'hui prescrit de manière plus large. Il s'agit du méthylphénidate7, une substance de la même famille des amphétamines ou stupéfiants mais à usage thérapeutique. Cette substance agit en effet sur la captation de la dopamine et de la noradrénaline, qui sont en jeu dans le la manifestation du trouble comme nous venons de le voir. Les effets sur les enfants sont globalement positifs et l'entourage observe un apaisement dans le comportement de l'enfant.
Peut-on alors le considérer comme un remède miracle ? Même s'il aide les individus qui en reçoivent la prescription, le traitement implique aussi des effets secondaires très fréquents8 comme les maux de tête et une perturbation du sommeil. Il est également contre-indiqué en cas de problèmes cardiaques mais aussi des autres troubles psychiques qui sont pourtant fréquemment associés au TDAH8. De plus, le médicament agit comme un «pansement» sur les symptômes, il ne «guérit» pas du TDAH il n'agit pas sur son développement, rendant la personne potentiellement dépendante à long terme pour vivre correctement. Le problème est qu'il y a encore peu de recul sur les effets secondaires à long terme, mais certaines études9 commencent à observer un lien avec des maladies cardiovasculaires prévalentes.
Plus grave encore, certains enfants pourraient être diagnostiqués TDAH alors qu'ils ne le sont pas et recevoir une médicamentation inadaptée. Peu d'études ont été réalisées en France, mais en Amérique du Nord10, elles ont conclu à un surdiagnostic du trouble sur des enfants présentant d'autres troubles comme l'épilepsie, l'autisme ayant des symptômes en commun. De plus, il ne faut pas oublier que ces symptômes doivent être présents depuis le début de l'enfance et ne doivent pas survenir à cause de l'environnement familial: en effet, le manque d'activité physique, l'usage abusif d'écran, l'excès de sucre peuvent favoriser un comportement hyperactif et des problèmes pour gérer l'attention mais ils ne sont pas d'origine héréditaire.
LES ALTERNATIVES À LA MÉDICAMENTATION
Outre la médicamentation aux effets miracles et spontanés, il existe des alternatives thérapeutiques qui permettent sur le plus long terme, de réguler et apaiser les symptômes du trouble et même de compenser certains déficits. Même si ces conseils peuvent s'appliquer à tous les enfants, y compris ceux n'étant pas atteints de trouble, un respect rigoureux de ces principes facilite le quotidien des TDAH et peuvent éviter une médicamentation :
- les adaptations à l'école : place dans la classe, permission de sortir pour se défouler... voir la fiche sur TDAH France
- limiter les écrans et les adapter à chaque âge : les études scientifiques sont unanimes, l'usage inadapté d'écrans défavorise le bon développement de l'enfant11 et aggrave le trouble TDAH car les enfants atteints y sont encore plus sensibles. Pour plus de repères, vous pouvez télécharger la fiche du gouvernement «Bien grandir avec les écrans» ou celle de l'association «Lâche ton écran».
- pratiquer des activités en plein air de manière quotidienne : des études récentes12 13 14 15 révèlent les bienfaits du plein air et de la place de la nature dans la vie des enfants TDAH, diminuant leurs symptômes. Pas besoin de se creuser la tête : la marche simple est un besoin fréquent des personnes atteintes d'hyperactivité et permettant de les soulager16 !
- éviter les excès de sucre : pendant longtemps, on a cru que le sucre pouvait être en cause dans l'hyperactivité. Si cette idée est aujourd'hui révolue, il faut néanmoins faire attention à ses excès car, même s'ils ne sont pas cause, ils aggravent tout de même les symptômes17.
- soigner le rythme du sommeil : le TDAH est souvent lié à des troubles du sommeil 18 19 comme la difficulté à s'endormir ou au contraire se réveiller, le manque de sommeil, de longs sommeils mais peu réparateurs. Afin de diminuer le problème et favoriser la concentration ainsi que la mémorisation, il faut donc consacrer une attention particulière au sommeil : respecter les temps de sommeil préconisés en fonction de l'âge (entre 10 et 14h pour un enfant), se coucher et se lever à des heures régulières, aider à l'endormissement par des rituels, s'aider de médicaments doux comme la mélatonine ou certains histaminiques. Téléchargez les affiches suivantes pour aider votre enfant à réguler son sommeil : Le Temps de sommeil par âge et Le Chemin du Sommeil.
MESURER LA BALANCE BÉNÉFICES-RISQUES
Est-il nécessaire de donner une médicamentation à base de stupéfiant pour soigner le TDAH ? Il apparaît d'après les études mises en jeu dans le paragraphe précédent qu'il y ait de nombreuses alternatives thérapeutiques à la médicamentation. Par ailleurs l'Organisation Mondiale de la Santé20, ne recommande plus la médicamentation pour les TDAH car le comité scientifique a des doutes sur les réels bienfaits de la substance et il alerte sur la prescription abusive sans autre alternative thérapeutique21. Par ailleurs on pourrait estimer que la médicamentation ne devrait pas remplacer une hygiène de vie saine, elle ne doit pas non plus compenser un déficit de l'accompagnement parental ou scolaire. La décision de médicamenter ne devrait peut-être intervenir que si, malgré toutes les aides et thérapies mises en place, les troubles deviennent ingérables et menacent considérablement la santé et l'avenir de l'enfant.
SOURCES
- DSM-5, Manuel Diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, p.67 [lecture du pdf, p. 126]
- Haute Autorité de Santé : «Trouble déficit de l'Attention avec ou sans hyperactivité» [lecture de l'article]
- Le Mini Coach TDAH : «Comprendre le cerveau TDAH» [lecture de l'article]
- Institut du Cerveau : «Noradrénaline» [lecture de l'article]
- Le Manuel MSD : «Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité» [lecture de la fiche]
- CHU Sainte-Justine : «Quelles sont les causes du TDAH ?» [lecture de l'article]
- Vidal : «Méthylphénidate» [lecture de la fiche]
- Base de donnée publique des médicaments : «Méthylphénidate» [lecture de la fiche]
- Centre belge d'information pharmacothérapeutique : «Utilisation prolongée de médicaments du TDAH et risque cardio-vasculaire : nouvelles données [lecture de l'article]
- Revue Études : «La fausse épidémie de TDAH» [lecture de l'article]
- Institut Neurosens : «Temps d'écran : Amis ou ennemis pour les enfants TDAH?» [lecture de l'article]
- CCNSE : «Les espaces verts peuvent atténuer les symptômes de TDAH chez les enfants» [lecture de l'article]
- EHP Publishing : «Green and Blue spaces and behavioral development in Barcelona school children: The BREATHE project [lecture de l'étude en anglais]
- National Library of Medicine : «A Potential natural treatment for Attention-deficit/Hyperactivity Disorder : Evidence from a National Study [lecture de l'étude]
- Louis Espinassous, Le Besoin de Nature, 2014. Fiche de présentation de l'oeuvre sur Santé des Enfants & Environnement : «Le besoin de nature selon Louis Espinassous» [lecture de la fiche]
- Le Mini Coach TDAH : «TDAH et Marche» [lecture de l'article]
- Cerebrostim : «Le sucre et les symptômes de TDAH» [lecture de l'article]
- SOS Oxygène : «TDAH et troubles du sommeil : un lien méconnu mais fréquent» [lecture de l'article]
- Centre en Neurosciences de Lyon : «TDAH et Sommeil : une relation bidirectionnelle» [lecture du pdf]
- OMS, «L'OMS actualise ses orientations mondiales sur les médicaments et les outils de diagnostic pour répondre à certains problèmes de santé, privilégier les traitements très efficaces et rendre les traitements plus abordables» [lecture de l'article]
- OMS, «Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) guideline for mental, neurological and substance use disorders» p.28 [lecture du pdf p.64]
À lire aussi
- L'article de l'Association québécoise des neuropsychologues sur le TDAH [lire l'article]
- L'article de l'Institution national de santé du Québec : «Ritalin(r) : pour ou contre ?» [lire l'article]
- L'ouvrage de Jean-Philippe Lachaux, Le Cerveau attentif, 2011